Films vus en compagnie
Matewan de John Sayles (1987)

- John Sayles est un écrivain et réalisateur américain de gauche qui fait des films à petit/moyen budget très engagés sur des questions généralement sociales et/ou raciales. J’avais apprécié Brother (1984), de la SF fauchée sur un extra-terrestre noir poursuivi par des chasseurs de primes de l’espace, et Lone Star (1996) avec un shérif texan confronté aux tensions interraciales près de la frontière. Dans une ambiance très différente, j’avais bien aimé également Le secret de Roan Inish (1994), autour d’une communauté de pêcheurs irlandais pauvres dans un récit teinté de merveilleux. Matewan se penche sur un évènement célèbre de l’histoire sociale américaine, la bataille de Matewan, où une communauté de mineurs a résisté aux expulsions de famille ordonnées par la direction (attention : la page wikipedia spoile).
Matewan n’est pas historiquement juste dans les détails, il cherche à retranscrire l’ambiance de l’époque, les questionnements des mineurs et les interactions entre les communautés. John Sayles crée de toute pièce son héros Joe Kenehan, invente des méchants détestables et mélange les évènements pour rendre la narration plus dense et plus cinématographique. Bien que comprenant ses motivations, cela engendre plusieurs problèmes : - • En important de l’extérieur un homme détenteur du savoir, il gomme l’expérience des mineurs déjà très politisés et bien au fait des problématiques syndicales. De façon générale, il se concentre trop sur le local alors que Matewan n’est qu’un exemple parmi d’autres d’un phénomène global à cette époque ;
- • Il minimise le rôle des femmes, que ce soit dans le quotidien ou dans la lutte, la Virginie-Occidentale étant notamment un des terrains d’intervention de l’organisatrice syndicale Mother Jones, très célèbre à l’époque ;
- • C’est dommage qu’il se sente obligé de mettre des méchants très méchants pour révulser le spectateur et le faire adhérer aux positions des mineurs : les conditions d’exploitation étaient suffisamment révoltantes, il n’y avait pas besoin d’en rajouter. Il se focalise beaucoup trop sur l’agence de détectives privés, mettant au second plan les patrons et l’Etat américain, qui finira par envoyer les troupes fédérales pour mater les contestations dans la région. Malgré tout, Matewan reste incontournable et met en valeur une histoire sociale invisible dans les médias. Il montre la solidarité des mineurs à une époque où les autres syndicats pratiquaient la ségrégation, et l’importance du mouvement syndical dans les luttes. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que, quand sort Matewan en 1987, le président Ronald Reagan menait, à l’image de sa consœur Thatcher en Grande-Bretagne, une politique de destruction systématique des grandes fédérations syndicales. Il se questionne enfin sur le recours à la violence comme moyen de contestation dans un endroit coupé du monde extérieur et où le patronat fait sa loi.
Steel Magnolias de Herbert Ross (1989, Potins de femmes)

Steel Magnolias est scénarisé par l’auteur de la pièce éponyme, écrite en l’honneur de sa sœur. Durant la quasi-totalité du métrage, l’origine théâtrale est visible, que ce soit dans les dialogues ou par le montage, qui saute d’une scène de discussion dans un lieu fixe à une autre. Certaines ne durent que dizaines de seconde et servent juste à placer un bon mot. On se demande un peu où tout cela mène jusqu’au dernier tiers, moins figé et qui fonctionne mieux. C’est dommage car la dynamique entre les actrices est bonne. Confié à un autre réalisateur (ce qui n’aurait pas été un mal, Herbert Ross ayant apparemment été ignoble sur le tournage) et scénarisé par quelqu’un d’un peu plus extérieur vis-à-vis du texte d’origine, ça aurait pu donner quelque chose de très bien. En l’état, ça ne casse pas trois pattes à un canard.
Jurassic World de Colin Trevorrow (2015)

Rien à sauver dans le premier épisode de la trilogie Jurassic World, 14 ans après le mauvais Jurassic Park 3 dont je ne me souviens plus du tout et ce n’est pas plus mal. Sans une once d’originalité, les scénaristes ont repris le duo d’enfants perdus dans la jungle, les vélociraptors, les dinos qui s’échappent, le thème de John Williams… Heureusement en même temps car les vélociraptors et le thème musical sont les seuls trucs potables, le reste étant complètement indigent. Le héros est un bad boy qui fait chavirer le cœur de l’héroïne avec ses gros muscles, héroïne qui passe en deux secondes de la méchante capitaliste à la femme sensible émue par les animaux et les enfants. C’est complètement nul et le pire est que je vais sans doute voir les deux épisodes suivants.
きのう何食べた? [Kinô nani tabeta?] de Kazuhito Nakae (2021, What Did You Eat Yesterday?)

What Did You Eat Yesterday? est au départ un manga débuté en 2007 et toujours en cours de parution. Il a été adapté en TV drama en 2019 et la série a connu un immense succès, poussant les producteurs à la porter au cinéma avec le même casting. C’est un adroit mélange de comédie romantique et de préparations culinaires. La gastronomie est très à la mode au Japon depuis des années, à l’image du diptyque Petite forêt (2014-2015) chroniqué précédemment.
L’homosexualité au Japon est un sujet complexe que je ne maîtrise pas bien, n’ayant jamais lu d’étude approfondie sur le sujet. De ce que j’en sais, elle était perçue de manière assez neutre avant l’occidentalisation du Japon durant l’ère Meiji, puis a progressivement été rejetée à partir de la fin du XIXe siècle. Elle commence à être mieux acceptée ces dernières années, notamment dans les grandes villes, et certaines personnalités se mettent à faire leur coming-out. Cela demeure marginal et l’autorisation du mariage entre personnes de même sexe n’est pas à l’ordre du jour (Taïwan est le seul pays d’Asie qui l’autorise). What Did You Eat Yesterday? montre d’ailleurs bien les réticences encore présentes, par exemple chez la mère de Shiro qui ne souhaite pas voir Kenji.
De façon assez paradoxale, dans les arts et dans les mangas, la représentation des amours homosexuels a toujours été répandue et il existe même un genre, le yaoi, consacré uniquement aux romances entre hommes. Il est principalement destiné aux femmes et comporte en général du sexe explicite. What Did You Eat Yesterday? se démarque par la faible sexualisation de la relation entre Shiro et Kenji, pour se concentrer sur les évènements de la vie quotidienne. C’est une comédie très simple et gentille avec quelques bonnes recettes que je pourrais tester à l’occasion.
Films vus seuls
絕代雙驕 [Jue dai shuang jiao] de Yuen Chor (1979, The Proud Twins)

Alexander Fu Sheng est un des premiers acteurs important spécialiste de rôles comiques dans des films d’arts martiaux, vu par beaucoup comme un précurseur de Jackie Chan. Il est décédé en 1983 à 28 ans à l’apogée de sa carrière dans un accident de voiture. Je n’ai jamais été un grand fan, les comédies de la Shaw avec lui sont souvent lourdingues et son jeu n’est guère subtil. C’est le cas ici, Alexander Fu Sheng est pénible et c’est embêtant car tout tourne autour de lui. J’ai préféré l’adaptation du même roman par Chun Yen 8 ans plus tôt. Bien que plus brouillonne, elle était plus rythmée, plus folle et c’était une bonne idée de transformer le héros en héroïne.
二階の他人 [Nikai no tanin] de Yôji Yamada (1961, The Strangers Upstairs)

Nikai no tannin est la première réalisation de Yôji Yamada, alors âgé de 30 ans. C’est un SP (ou Sister Picture), moyen métrage projeté avant un long métrage. Le concept se rapproche de la série B à l’américaine et permettait aux studios de tester un metteur en scène inexpérimenté sans risque, les spectateurs se rendant dans les salles pour le titre principal et non pour le SP. A la demande de la Shôchiku, Yôji Yamada a dû transformer en comédie un roman policier de l’écrivain Kyô Takigawa. Cette origine se sent surtout dans la deuxième partie, avec un suspens construit autour du remboursement d’une grosse somme d’argent. Pour un premier film, c’est plutôt bien mené, malgré plusieurs personnages secondaires assez agaçants. Rien de mémorable toutefois, c’est plus une petite curiosité pour les fans de Yôji Yamada (ou les complétistes comme moi).
神在月のこども [Kamiarizuki no kodomo] de Takana Shirai (2021, L'enfant du mois de Kamiari)

Je suis tombé par hasard sur Netflix sur cet animé assez mal noté. Il n’avait pas l’air vilain techniquement et j’étais curieux. Malheureusement, la note est justifiée, ce n’est vraiment pas terrible. C’est une production du studio Liden Films, plutôt spécialisé dans les séries TV. Le financement a été assuré en partie par un crowfunding et c’est la première réalisation de Takana Shirai. Le scénario, qui ne provient pas d’un manga pour une fois, est assez faible : les personnages n’ont aucune profondeur, les situations sont terriblement classiques et la résolution complètement prévisible. Dispensable.
മിന്നൽ മുരളി [Minnal Murali] de Basil Joseph (2021, Minnal Murali: Par le pouvoir de l'éclair)

L’appropriation du genre typiquement hollywoodien des super-héros par d’autres cultures donnent souvent des résultats intéressants, pour le meilleur comme le japonais Go Find a Psychic! (2009), le français Vincent n’a pas d’écailles (2014) ou le finlandais The Innocents (2021) , ou pour le pire comme le nanardesque italien L'incroyable homme puma (1980). J’avais entendu parler positivement de Minnal Murali dans Mad Movies, qui le mentionnait en passant dans un article. Je n’avais jamais vu de film malayalam et je m’attendais à une superproduction à la Bollywood ou Kollywood. Eh bien pas du tout, le cinéma malayalam est apparemment connu pour son progressisme et son réalisme et n’a clairement pas des budgets gigantesques.
Minnal Murali a une trame scénaristique ultra-classique, un gentil et un méchant qui découvrent leurs pouvoirs et finissent par s‘affronter. Sauf que c’est ancré dans le quotidien d’un village, tout est à une échelle humaine, et on passe beaucoup de temps sur la vie des héros et sur leurs interactions avec la communauté. Ça change des Marvel récents et ça évoque un peu les comics des années 60-70, qui se préoccupaient plus des questions sociales et proposaient des univers crédibles. J’ai trouvé Minnal Murali fort sympathique, il dégage une sincérité et un amour du genre que je n’avais plus vu depuis longtemps, à des années-lumière de l’affreux Thor : Love and Thunder (2022). Les acteurs et actrices ne sont pas spécialement beaux, les décors font vrais, les effets spéciaux sont limités et utilisés à bon escient. La storyline du méchant est bien construite, sans manichéisme excessif. Même l’humour, généralement pénible dans les productions indiennes, est léger et passe sans problème. Quelques chansons intégrées au récit agrémentent le métrage. Il a très bien marché en Inde et j’espère juste que, en cas de suite, ils sauront rester modestes et garder le même esprit.
Mal de Espanha de José Leitão de Barros (1918)

Mal de Espanha est la première réalisation de José Leitão de Barros, juste avant Malmequer (1918). Les deux courts métrages ont été produits par la compagnie Lusitânia Film, qui fera faillite l’année suivante. Mal de Espanha a été tourné principalement sur la plage de Caxias, à côté de Lisbonne, avec quelques intérieurs dans une salle du palais royal de Queluz (palais également utilisé dans Malmequer). José Leitão de Barros se moque de l’attraction que les artistes espagnoles exerçaient à l’époque sur les bourgeois portugais. Le scénario est plus évolué que Malmequer, c’est néanmoins platement filmé et très statique, rappelant le cinéma des années 1900.
Livres
L’île des morts de Roger Zelazny (J’ai lu, 1973), 192 p.

L’île des morts est un roman écrit dans la première partie de la carrière de Zelazny. On y retrouve déjà la plupart de ses thèmes de prédilection, avec son héros immortel habité par un Dieu, qui réussit à déjouer toutes les embuches par sa puissance et son intelligence. Le livre est écrit à la première personne, du point de vue de Francis Sandow, qui découvre progressivement le piège qu’on lui a tendu. Le problème est qu’on ne ressent guère d’empathie pour lui et que les aventures s’enchaînent de façon un peu artificielle. J’aimais beaucoup Zelazny quand j’étais jeune, ses bouquins se démarquaient des classiques récits d’apprentissage ou de bouleversement de la vie d’un être ordinaire. Avec le temps, ça devient lassant, c’est toujours un peu pareil. Pas désagréable, ça se lit facilement, juste que l’effet nouveauté est passé et je suis devenu plus exigeant.
- Les Sciences participatives au secours de la biodiversité de Florian Charvolin (Editions Rue d’Ulm, collection « Sciences durables », 2019), 76 p.Les cinq chapitres de ce petit livre constituent un survol sociologique de l’état actuel des sciences participatives :

- • Une courte présentation de l’histoire des sciences participatives, moins récentes qu’on ne le pense
- • Une description du cadre protocolaire couramment utilisé sur le terrain
- • Les difficultés à connaître en détail les contributeurs aux sciences participatives
- • Les raisons qui poussent les amateurs à contribuer
- • Les bouleversements liés à l’arrivée du numérique et du big data
Deuxièmement, il manque une définition claire de ce que l’auteur entend par sciences participatives. Cela peut paraître évident, ça ne l’est pas. J’ai ainsi dû attendre le dernier chapitre pour comprendre qu’il mettait à part les données opportunistes (données entrées par des amateurs hors du cadre d’un protocole clairement défini sur une durée prédéterminée) et que l’essentiel de ses analyses se limitaient aux données protocolées. Les données opportunistes sont pourtant la source la plus importante en volume, notamment via le site Faune-France, et répondent à des problématiques parfois différentes. La façon dont l’auteur conçoit les sciences participatives semble également changer à chaque chapitre : le premier sur l’historique prend en compte les données opportunistes, pas le second sur les protocoles, et on ne sait pas trop sur ceux qui viennent ensuite. Il y a peut-être également d’autres soucis que je n’ai pas vus, n’étant pas un spécialiste du domaine mais juste un participant occasionnel.
Passé ces deux problèmes non négligeables, c’est une présentation facile et rapide à lire, qui permet de bien contextualiser la situation des sciences participatives en France à l’heure actuelle, avec ses forces et ses faiblesses. Il pose en outre de bonnes questions pour appréhender les limites du phénomène, à la fois sur le petit nombre de volontaires et la difficulté de maintenir leur motivation dans le temps. Il y aurait sans doute beaucoup d’autres choses à dire, les recherches approfondies sur le sujet commencent juste à être réalisées. Ce court texte est une bonne première approche, qui permet de mettre un pied dans le sujet sans rebuter le néophyte.
La promesse de Shôhei Kusunoki (Cornélius, collection « Pierre », 2009), 304 p.

Je continue mon exploration du gekiga, après les œuvres de Masahiko Matsumoto et de Yoshiharu Tsuge. Je n’avais jamais entendu parler de Shôhei Kusunoki, ce n’est guère étonnant vu la brièveté de sa carrière. Atteint de problèmes cardiaques depuis l’enfance, la maladie hante ses récits. L’optimiste n’est guère de mise, un destin inéluctable pèse sur les protagonistes. J’ai trouvé que la qualité de la narration augmentait au fil du temps et j’attends avec impatience de lire le deuxième recueil publié par Cornélius.
Revues
Mad Movies n°367 – Janvier 2023

Le bilan 2022 de la rédaction n’a pas suscité d’envie particulière, il m’a juste rappelé l’existence de Decision to Leave (2022), qu’il va falloir que je regarde, et de Men (2022), qui était un peu sorti de mon esprit. Le dossier sur Starship Troopers est intéressant et j’aime bien cette citation de Verhoeven : « Je voulais engager de beaux acteurs susceptibles d’attirer la sympathie du public. Et en cours de projection, je voulais dire au spectateur : « Au fait, ce sont des nazis ! » ». J’ai moins accroché au dossier sur les films de bande, je connais la plupart des titres cités et ça n’a jamais été mon truc.
En cinéma de patrimoine enfin, pas moyen de me souvenir si j’ai déjà vu Seven Swords (2005) de Tsui Hark. Dans le doute, je vais dire que non et il faudrait que je le récupère, peut-être le coffret Spectrum Films qui contient également une traduction d’un bouquin de Stephen Teo que je voulais lire. Je ne sais plus non plus si j’ai vu Doomsday (2008) de Neil Marshall, réalisateur du distrayant Dog Soldiers (2002) et du bon The Descent (2005). Mad Movies en dit beaucoup de bien mais, de mémoire, j’en avais eu des échos négatifs à sa sortie. Ils mentionnent également positivement Sorcière (2020) et The Lair du même metteur en scène, dont les notes à moins de 5 sur imdb font peur. Je remarque enfin la curiosité Le drive-in de l'enfer (1986), de l’ozploitation qui a l’air terriblement kitsch.









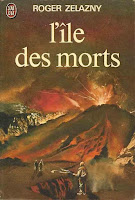



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire