Films vus en compagnie
ピンクレディーの活動大写真 [Pinku redi no katsudo dai shashin] de Tsugunobu Kotani (1978, Pink Lady's Motion Picture)

Deux amies d’enfance, Mie (Mitsuyo Nemoto) et Kei (Keiko Masuda), formèrent en 1976 le duo Pink Lady. Jusqu’à leur séparation en 1981, elles furent immensément populaires, enchaînant les tubes et réunissant 100 000 spectateurs dans un concert géant à Tôkyô en 1978 (dont des morceaux sont régulièrement diffusés au cours de Pinku redi no katsudo dai shashin) et 200 000 fans à Ôsaka en 1979. Elles eurent une brève carrière américaine, avec un show TV de six épisodes sur NBC en 1980. Pinku redi no katsudo dai shashin est leur unique long métrage trouvable sur internet. Le second, Pîman 80 (1979), n’est apparemment jamais sorti sur support physique.
On sent que la mince trame à sketches a été conçue autour des titres de chansons connues de Pink Lady. Elles sont essentiellement extraites de concerts impressionnants par les moyens déployés, avec des costumes et des chorégraphies très années 70. La musique n’est pas désagréable, de la pop japonaise à la ABBA (Pink Lady reprit d’ailleurs That’s Me de ABBA en 1978 pour leur album America! America! America!). Le reste est en revanche médiocre, avec des interprètes en roue libre et des segments inégaux, le plus distrayant étant la partie western avec des personnages aux noms de bouffe pour justifier l’insertion de leur tube Pepper Keibu (= inspecteur Poivre, ici un shérif mais on n’est pas à une approximation près).
Tirlittan de Maunu Kurkvaara (1958, Tweet, Tweet)

Tirlittan est tiré d’un fameux livre pour enfants d’Oiva Paloheimo publié en 1953. C’est une espèce de conte sur une fillette en pyjama devenue soudainement orpheline, à l'image de l’auteur séparé de sa mère à sa naissance et dont le père mourut quand il avait huit ans. L’adaptation de Maunu Kurkvaara, un cinéaste influencé par la Nouvelle vague française qui travaillait généralement avec une équipe réduite, fit un flop, mal reçue à la fois par la critique et par Oiva Paloheimo. Ses détracteurs estimaient qu’elle ne véhiculait pas l’aspect onirique du récit et que les dialogues sonnaient faux. N’ayant pas lu le texte d’origine, je n’ai pas de point de comparaison. Il est vrai cependant que les interactions ne sont pas convaincantes (notamment celles avec la vieille dame, incarnée par la grand-mère de Maunu Kurkvaara, ou avec les gens du cirque) et le traitement naturaliste a tendance à diminuer le merveilleux. Ce n’est toutefois pas inintéressant, avec un rythme lent assez déroutant et de beaux passages dans la forêt.
Ce fut l’unique apparition de Tarja Airaksinen (Tirlittan), écolière qui faisait du théâtre et qui joue correctement.
Mrs Dalloway de Marleen Gorris (1997)

Mrs Dalloway est tiré du roman éponyme de Virginia Woolf paru en 1925. Il y a une jolie reconstitution, les interprètes de la partie sur Clarissa sont plutôt bons et le résultat aurait pu être convenable avec un montage différent. Marleen Gorris alterne en permanence le passé et le présent de Clarissa, usant d’incessants flashbacks parfois très brefs, qu’elle ponctue des mésaventures de Septimus. Le lien entre ces deux histoires est ténu, les hallucinations de Septimus cassent l’ambiance et on ne voit pas trop ce que ça apporte, pas aidé par le jeu exagéré de Rupert Graves en Septimus. C’est seulement en conclusion qu’on comprend le truc, j’avoue m’être dit « tout ça pour ça… ». Cela fonctionne peut-être dans le bouquin mais pas à l’écran.
A noter que Mrs Dalloway a également inspiré The Hours (2002), qui se penche sur l’écriture du livre par Virginia Woolf et sur son influence sur deux femmes à deux époques.
Ed and Rooster's Great Adventure de Lucy Fazely (2021)

Ed and Rooster's Great Adventure est une découverte de M. Martin, qui a généreusement payé trois euros pour que nous puissions profiter de cette rareté. En dépit de son budget rachitique et de sa réalisation minimaliste (des goélands filmés dans le Michigan et en Floride doublés par d’obscurs acteurs), Ed and Rooster's Great Adventure m’intriguait. Au pire, je serais content de regarder des goélands pendant 1h16.
Dans les faits, cela s’est avéré soporifique. Outre un côté extrêmement amateur que franchement je pourrais faire mieux avec un logiciel de montage pro, les dialogues sont pénibles, jamais amusants et assez beaufs. Les images sont par ailleurs terriblement statiques, elles consistent essentiellement en des goélands posés qui bougent à peine. Pour avoir régulièrement observé des laridés, ça n’aurait pas été compliqué de faire plus dynamique. L’équipe n’a même pas été capable d’identifier correctement les espèces, appelant mouette tridactyle une mouette atricille. Pour donner un aperçu du niveau, l’émission La Vie privée des animaux avait davantage de tunes et était plus marrante… Les deux-trois bonnes idées et les mauvais effets spéciaux sympathiques ne suffisent pas. Lucy Fazely avait auparavant tourné la websérie Seagull Stories (2019), disponible sur Youtube, ce sera sans moi.
Une remarque pour terminer. La fiche imdb indique des informations douteuses, avec une durée de 1h30 et une année de sortie en 2025. En réalité, Ed and Rooster's Great Adventure dure 1h16 (j’ai demandé la modification sur imdb) et date de 2021.
Los colonos de Felipe Gálvez (2023, Les colons)

Les Selknam (aussi appelés Onas) était un peuple autochtone qui habitait le Sud de la Patagonie chilienne et argentine. Sans se relater à des évènements historiques précis, Los colonos dépeint leur extermination entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Felipe Gálvez divise son film en deux parties : la première, qui occupe les trois quarts, se concentre sur l’expédition de MacLennan et les tourments de Segundo, tiraillé entre deux mondes, dans une ambiance western spaghetti moderne avec des paysages désolés, des antihéros taiseux et un chapitrage qui claque ; la seconde, qui se déroule sept ans plus tard dans des intérieurs sombres, opte pour un angle politique et cède la place à la parole.
Los colonos est le premier long métrage du monteur Felipe Gálvez. La photographie est superbe et le thème osé, le sujet étant rarement abordé au Chili et la famille Menéndez continuant à être influente dans la région. Felipe Gálvez a voulu adopter le point de vue des meurtriers afin de dénoncer les excès et la violence injustifiable. Il dresse un tableau au vitriol de la situation et tombe dans la facilité, avec des protagonistes ultra-manichéens (excepté Segundo qui reste malheureusement au second plan) et des scènes très brutales à la limite du sordide. Je ressors donc avec un sentiment mitigé, je pense qu’il y aurait eu moyen de faire autrement.
Watermelon Man de Melvin Van Peebles (1970)

N.B. : pour les non anglophones, le mot watermelon (= pastèque) renvoie à un stéréotype raciste datant du XIXe siècle. Après la guerre de Sécession, de nombreux noirs acquirent une indépendance économique en cultivant des champs de pastèque. Les Sudistes blancs retournèrent ce symbole en attribuant aux noirs un amour immodéré de la pastèque, associant le fruit à la saleté, l’immaturité et la paresse.
Watermelon Man fut écrit au départ par Herman Raucher, un scénariste blanc, pour se moquer de ses amis libéraux qui dissimulaient un fond raciste. Intéressé mais effrayé par le script, la Columbia confia le projet à un réalisateur noir indépendant, Melvin Van Peebles, qui venait de se faire remarquer avec La permission (1967). Le studio songeait à un acteur blanc en blackface du type Jack Lemon pour le rôle principal avant que Melvin Van Peebles les convainque fort heureusement de sélectionner un comédien noir populaire, Godfrey Cambridge. Il modifia également la conclusion en supprimant l’inoffensif « ceci n’était qu’un rêve » par quelque chose de plus revendicatif. Il se heurta de façon générale à Herman Raucher, qui avait conçu une aimable satire, tandis que Melvin Van Peebles avait des arrière-pensées politiques qui transparaissent notamment dans les chansons qu’il a composé lui-même. Ce fut son seul opus hollywoodien, il refusa un deal avec Columbia et employa l’argent recolté pour produire Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971), emblème de la blaxploitation indépendante (assez douloureux à regarder de nos jours).
Ces tensions entre le matériau d’origine et les intentions de Melvin Van Peebles sont palpables, avec une mise en place lourdingue desservie par un Godfrey Cambridge en roue libre. Au bout d’un moment, le ton change, le jeu de Godfrey Cambridge perd sa loufoquerie et gagne en mélancolie. L’humour devient acerbe, avec des attaques contre la police, les voisins proprets, le patron opportuniste ou la femme de Jeff confrontée à ses contradictions. Althea est parfaitement interprétée par Estelle Parsons, qui réussit à rendre le personnage à la fois léger et triste. Watermelon Man mérite donc de s’accrocher au-delà de sa première demi-heure poussive.
Films vus seuls
Santo contra los secuestradores de Federico Curiel (1973, Santo vs. the Kidnappers)

Oh que ce Santo était pénible, peut-être pire encore que Misión suicida du même duo Jorge Camargo/Federico Curiel. Un peu comme Santo contra Capulina (1969), Santo contra los secuestradores est en réalité un show d’un comique à la mode, l’équatorien Ernesto Albán, créateur du personnage d’Evaristo Corral y Chancleta. Il est accompagné d’Elsa incarnée par Rossy Mendoza, une danseuse de cabaret sexy qui se spécialisera dans le cine de ficheras, un sous-genre de la sexploitation apparu en 1975.
Santo sert de faire-valoir dans une intrigue quasi-inexistante, prétexte à enchaîner les numéros de danse d’Elsa (constitués essentiellement de zooms sur son corps qui se trémousse avec une caméra secouée dans tous les sens) et les scènes humoristiques avec Evaristo. C’est extrêmement mal filmé, avec un combat de catch en plans serrés pour qu’on ne se rende pas compte que ça a été tourné dans un studio avec dix figurants. A fuir.
A noter que quand Santo va dans un night-club, il commande une limonade.
コアラ課長 [Koara kachô] de Minoru Kawasaki (2005, Executive Koala)

Minoru Kawasaki s’est fait connaître en 2004 avec The Calamari Wrestler, une péloche fauchée dans laquelle un catcheur professionnel se transforme en calmar géant. Il poursuit cette veine animalière avec Koara kachô où, outre un koala humanoïde, apparaissent un lapin blanc en costard, une grenouille employée de superette et surtout Momo, un écureuil volant de compagnie. Il n’y a clairement pas de tunes, la plupart des interprètes sont débutants ou viennent de la télévision, avec une esthétique assumée de TV drama et un scénario totalement débile quoique cohérent. Et pourtant, hors quelques longueurs vers la fin, ça fonctionne grâce à son absurdité revendiquée et à l’honnêteté de la chose. Minoru Kawasaki ne ment pas sur sa marchandise, on a un koala en col blanc, des meurtres sanglants, de la romance et une enquête policière. Je n’ai donc pas été déçu et je compte récupérer d’autres opus de ce réalisateur.

La première rencontre de Tamura le koala et de Momo l'écureuil volant
La marca de Satanás de Chano Urueta (1957, The Mark of Satan)

La marca de Satanás est une curieuse fausse suite d'El jinete sin cabeza (1957). On y retrouve une distribution identique dans des rôles différents, avec une intrigue confuse et un fantastique davantage présent. Même le héros Luis Aguilar change de nom, El jinete devenant El charro. Il est toujours accompagné de sa bande de trois mariachis et de son acolyte peureux, pousse toujours la chansonnette et porte son masque noir qui dissimule son visage. On ne sait en revanche pas ce qu’il fait là, ni pourquoi il met cette cagoule. Le reste est à l’avenant, on a du mal à comprendre les motivations des protagonistes et on finit par décrocher un peu. C’est dommage car c’est bien joué, avec une ambiance horrifique réussie et deux-trois bonnes chansons (paradoxalement, ce ne sont pas celles de Luis Aguilar que j’ai préférées). J’espère que le troisième volet se tiendra mieux.
ガリバーの宇宙旅行 [Garibaa no uchû ryokô] de Yoshio Kuroda (1965, Gulliver's Travels Beyond the Moon)

En 1956, la Toei racheta le studio d’animation Nichidô Eiga et le renomma Toei Dôga (ou Toei Animation en anglais). Sa première production en 1958 fut Le serpent blanc, tiré d’une légende chinoise, qui donna envie à Hayao Miyazaki de travailler dans l’animation. Il eut un énorme succès au Japon et fut diffusé à l’étranger. Garibaa no uchû ryokô est leur dixième long métrage, lointainement inspiré des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Escomptant des ventes à l’international, ils étaient alignés à l'époque sur un modèle à la Disney : ils visaient un public enfantin, enchaînaient les chansons (j’en ai décompté cinq), mettaient systématiquement en avant des animaux mignons dont des mascottes avec des rôles importants (ici Mack le chien et Kuro le corbeau).
D’après l’animateur Yasuo Ôtsuka, Hayao Miyazaki, intervalliste récemment embauché, suggéra la conclusion où un robot se transforme en humain. L’idée est jolie mais n’est pas franchement cohérente dans le contexte et le scénario demeure simpliste. Techniquement, c’est d’un bon niveau, l’animation est fluide et le montage est maîtrisé. Il faut cependant avouer que c’est gentillet et mollasson selon les standards actuels, et que l'intérêt est surtout historique.
Livres
The Honjin Murders de Seishi Yokomizo (Pushkin Vertigo, 2019), 189 p.

Ayant lu tous les Seishi Yokomizo parus en français (pas difficile, il n’y en a que trois : Le village aux huit tombes, La hache, le koto et le chrysanthème et La ritournelle du démon), je bascule sur les traductions américaines de Pushkin Vertigo, qui a édité les trois romans mentionnés précédemment et trois inédits en français.
The Honjin Murders est la première aventure de Kôsuke Kindaichi, qui marque sa rencontre avec l’inspecteur Isogawa. Elle fut publiée sous forme de feuilleton d’avril à décembre 1946 dans le magazine Hôseki. Seishi Yokomizo écrivait des romans policiers depuis les années 30 mais avait dû faire une pause durant la guerre, le genre n’était guère apprécié des autorités nationalistes. Juste après la guerre, il inventa le détective Kôsuke Kindaichi, un homme négligé et légèrement bègue qui résout ses enquêtes par déduction. Il devint le héros de la majorité des œuvres de Seishi Yokomizo, apparaissant dans soixante-dix-sept récits.
The Honjin Murders est un meurtre en chambre close conscient de son statut, Kôsuke Kindaichi citant fréquemment des exemples classiques centrés sur ce procédé. L’intrigue est plus linéaire et moins tordue que les Seishi Yokomizo que j’avais pu lire jusqu’à présent. Le nombre de protagonistes est restreint, à peine une dizaine, et ils sont listés au début (sans doute un ajout de Pushkin Vertigo car les deux autres volumes de la collection que j’ai acquis comportent cet élément). Le style est agréable, avec un narrateur omniscient qui cède parfois la place à des personnages secondaires. Je n’ai pas retrouvé le problème de tournures un peu trop simples qui m’avait gêné dans La ritournelle du démon, cela venait donc probablement bien d’un choix de traduction. Le contexte est intéressant, on voit le Japon campagnard d’avant 1945 divisé en classes rigides et imprégné du poids des traditions familiales qui repose sur les épaules de l’aîné. C’est pour l’instant le Seishi Yokomizo que j’ai préféré, dommage qu’il n’existe pas en français.
The Honjin Murders a été adapté deux fois au cinéma (et trois fois à la télévion) : une version de 1947 introuvable de Sadatsugu Matsuda ; et une de 1975 de Yoichi Takabayashi, qui a modernisé l’histoire en la plaçant dans les années 70 (ça coutait moins cher). De mémoire, cette actualisation n’est pas très heureuse et Akira Nakao ne m’a pas convaincu en Kôsuke Kindaichi.
Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro (Six pieds sous terre, collection « Monotrème », 2017), 72 p.

Je dois avouer que je n’y connais rien en BD française et que je n’avais jamais entendu parler de Zaï Zaï Zaï Zaï, qui semble pourtant être une référence adaptée sur grand écran en 2022 (pour un résultat apparemment catastrophique, comme le laisse présager la bande-annonce).
Zaï Zaï Zaï Zaï eut une influence non négligeable sur la carrière de Fabcaro, qui passa soudainement de l’ombre à la lumière. Bon gré mal gré, il adopta dès lors régulièrement le procédé de la case fixe avec un style épuré basé sur des photos, dans une logique de plan fixe cinématographique. Il fit école, une frange de la BD française s’inspirant de sa technique, souvent par facilité.
Zaï Zaï Zaï Zaï propose un humour absurde assez réjouissant, couplé à une vision acerbe de notre société de consommation intolérante. Il se moque de la police, des médias, du racisme ordinaire, sans se départir de son ton léger nonsensique. Une belle réussite qui me pousse à creuser l’œuvre de Fabcaro.
Le monde de Miyazaki de Susan Napier (IMHO, collection « Cinéma », 2021), 368 p.

- Susan Napier a effectué un impressionnant travail de compilation et d’analyse pour livrer un ouvrage enrichissant, qui permet de mieux appréhender le monde de Miyazaki. Par rapport à ses bouquins de recherche, elle a simplifié son style et limité ses observations psychanalytiques, bien qu’elle conserve une manie de surinterpréter les intrigues de Miyazaki au prisme de son enfance et de sa relation avec ses parents.
Le monde de Miyazaki n’est néanmoins pas exempt de défauts. Tout d’abord, elle commet des erreurs. Quelques exemples : - • Elle dit que Princesse Mononoke (1997) est le « premier [film] de l’œuvre de Miyazaki diffusé en Occident » (p.14). C’est une vision très américano-centrée. En France, Porco Rosso (1992), doublé par Jean Réno, sortit en juin 1995 et cumula presque 170 000 entrées. Mon voisin Totoro (1988) bénéficia aussi d’une diffusion en salles en décembre 1999 (374 452 entrées), un mois avant Princesse Mononoke (688 663 entrées, chiffres tirés de jpbox-office).
- • Momotaro, le divin soldat de la mer (1944), « qui dure plus de deux heures, est le premier long métrage d’animation japonais ». Momotaro, le divin soldat de la mer dure 1h14 : la pellicule étant rationnée en 1944, rares étaient les titres qui dépassaient 1h30 (et je pense qu’aucun n’atteignit deux heures, c'est pour ça que j'ai immédiatement tiqué).
- • Elle répète à deux reprises (p.204 et 217) que les paroles du Temps des cerises renvoient directement à la Commune de Paris. C’est faux puisque la chanson a été écrite en 1866 et que la Commune date de 1871. Combiné à un maniement discutable de certains termes (pillow-shot associé à Ozu et difficilement généralisable ; shôjo qu’elle utilise comme équivalent de fille, ce qui est littéralement exact mais étrange car le mot n’est habituellement pas employé de la sorte), cela génère une sensation d’amateurisme qui mine le propos.
En dépit de ces problèmes, Le monde de Miyazaki reste un apport intéressant à la compréhension de la filmographie de Miyazaki et sa lecture aisée le rend abordable au plus grand nombre.
Revues
Mad Movies n°391 – Mars 2025

Au niveau des nouveautés, je remarque le cambodgien Tenement (2024), pas forcément terrible mais qui vient d’un pays inhabituel ; The Monkey (2025), transposition d’une nouvelle de Stephen King ; Legends of the Condor Heroes: The Gallants de Tsui Hark (2025), même si je dois lire au préalable le bouquin en quatre parties qui traine en anglais dans ma bibliothèque ; et en patrimoine, Le plombier de Peter Weir, un téléfilm australien de 1979 potentiellement dangereux. Je signale pour finir une longue interview de Ti West, ça me rappelle que je n’ai toujours pas récupéré MaXXXine (2024), faudra corriger ça.












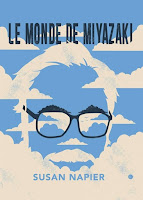

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire