Films vus en compagnie
Grizzly Man de Werner Herzog (2005)

Vu l’intérêt de Werner Herzog pour le thème de l’homme confronté à un environnement hostile dans une quête impossible (à l’image d’Aguirre, la colère de Dieu (1972) ou de Fitzcarraldo (1982)), il n’est pas étonnant que ce sujet ait pu l’enthousiasmer. Pour mettre la main sur les archives de Timothy Treadwell, il dut obtenir la collaboration de Jewel Palovak, une ex-compagne de Treadwell qui les conservait. Je ne sais pas si la nécessité d’avoir l’aval de celle-ci a adouci Herzog mais il se montre extrêmement complaisant dans son portrait. Timothy Treadwell était clairement un mégalo paranoïaque, ancien acteur raté qui voulait qu’on parle de lui et qui anthropomorphisait les animaux. Ses treize étés passés en Alaska n’ont pas l’air d’avoir servi à grand-chose pour l’amélioration de la condition des ours, il a pris des risques inconsidérés et a fini par en payer le prix. L’unique aspect tragique de l’histoire est la mort à ses côtés de sa copine du moment, Amie Huguenard. Grizzly Man s’est donc avéré être une déception compte tenu de sa réputation.
A Birder's Guide to Everything de Rob Meyer (2013)

Après le sympathique The Big Year (2011), voici une autre comédie américaine axée sur le birdwatching, sous-genre dont je risque de rapidement faire le tour si ce n’est pas déjà le cas. Elle est inspirée du court métrage Aquarium de Rob Meyer sur des amateurs de poissons, transformés ici en oiseaux afin de justifier un voyage initiatique. Le birdwatching n’est dès lors qu’un prétexte et occupe une place moins centrale que dans The Big Year. Si les interprètes sont convaincants, avec James Le Gros et Ben Kingsley dans des rôles secondaires, le scénario est faible, les protagonistes sont caricaturaux (notamment le pote « rigolo », vulgaire et misogyne) et les situations convenues, le déroulé étant prévisible de bout en bout. Sur le volet ornitho, ce n’est pas catastrophique grâce à la présence d’un expert sur le plateau. Cela n’a pas empêché deux-trois boulettes, en particulier concernant le canard mystérieux. C’est dans l’ensemble assez dispensable, mieux vaut revoir The Big Year.
The Man Who Shot Liberty Valance de John Ford (1962, L'homme qui tua Liberty Valance)

The Man Who Shot Liberty Valance est un chant du cygne de John Ford, son dernier western avec John Wayne qui se démarque de ses prédécesseurs des années 30 à 50 par son style et son sujet. Aux antipodes des extérieurs dans de splendides paysages qui l’ont rendu célèbre, Ford choisit un tournage intégralement en studio, essentiellement dans quelques pièces fermées, avec des plans souvent nocturnes dans un superbe noir et blanc à un moment où la couleur était généralisée pour les séries A. Au niveau des thèmes, s’il continue à explorer la construction des Etats-Unis, c’est cette fois avec un fort désenchantement en montrant la fin d’une époque. Pas de héros ici, Tom Doniphon reste dans l’ombre et Ransom Stoddard doit remiser ses principes au placard. Pour atteindre son objectif, il va adopter des valeurs qui le répugnent et se compromettre. On sent que le cœur de John Ford, pas franchement un grand progressiste, penche du côté des cowboys déclinants et voués à disparaitre. Le quatuor composé de James Stewart, John Wayne, Vera Miles et Lee Marvin est parfait bien que les deux premiers soient trop vieux pour leurs rôles. Edmond O'Brien et Andy Devine, chargés d’apporter la touche comique, sont en revanche lourdauds. The Man Who Shot Liberty Valance demeure un chef d’œuvre du cinéma classique hollywoodien, le Ford préféré de Sergio Leone.
Zazie dans le métro de Louis Malle (1960)

Zazie dans le métro est une adaptation libre par Louis Malle du livre éponyme de Raymond Queneau paru en 1959. Si Queneau parodiait des formes romanesques, Louis Malle détourne la tradition cinématographique. Dans la lignée de La Nouvelle Vague qui s’affirmait avec les succès des Quatre Cent Coups (1959) et de A bout de souffle (1960), Louis Malle s’attaque au cinéma de papa dans un style burlesque ponctué de faux raccords, de dialogues volontairement incompréhensibles et d’un rythme effréné. L’histoire sert de prétexte à une accumulation de courses-poursuites, de monologues absurdes et de scènes de groupe chaotiques. Cela m’a vite fatigué en dépit de bonnes idées de montage. C’est compliqué de fonder un film uniquement sur un rejet anarchique des règles établies, cela vieillit mal une fois sorti de son contexte.
La chambre verte de François Truffaut (1978)

La chambre verte est une combinaison de trois nouvelles d’Henry James : le cœur de l’intrigue provient de L'autel des morts, auquel a été ajouté des éléments de La bête dans la jungle pour la relation avec Cécilia et Les amis des amis sur l’anecdote autour de l’apparition de proches disparus. François Truffaut avait lui-même perdu de nombreux compagnons de route et considérait qu’il restait fidèle à ses morts à l’inverse de la plupart des gens. Il s’attribua le rôle principal de Julien Davenne et choisit Nathalie Baye pour incarner Cécilia, qu’il avait déjà employé dans La nuit américaine (1973) et dans L'homme qui aimait les femmes (1977). Truffaut n’est pas un acteur exceptionnel, son jeu morne et son ton monocorde accentuent l’antipathie qu’on éprouve pour Julien Davenne. Son obsession pour la mort est lassante et bornée, on se demande ce que lui trouve Cécilia. Le problème est qu’il est de tous les plans, tout est centré sur lui tandis que le film est censé prendre le parti de Cécilia. La chambre verte fut le plus gros échec commercial de Truffaut, je comprends pourquoi.
Kisapmata de Mike de Leon (1981)

Kisapmata est le quatrième long métrage de Mike de Leon, sorti un an après la délirante comédie Kakabakaba ka ba? (1980) bien que plus proche dans l’esprit de Itim (1976). Il met encore en vedette Charo Santos-Concio, révélée par Itim et héroïne de Kakabakaba ka ba?. Dadong est joué par Vic Silayan, un habitué des bad guy à l’affiche de plus de 300 films de 1953 à sa mort en 1987, et la mère par Charito Solis, une grande star dramatique.
Kisapmata est tiré d’un fait-divers, le meurtre en 1961 de sa famille par un ex-flic, immortalisé par le compte-rendu qu’en fit le journaliste et écrivain Nick Joaquin sous le titre The House on Zapote Street. Mike de Leon utilise ce point de départ pour brosser une critique acide de la dictature de Ferdinand Marcos et de la société patriarcale philippine, la maison de Dadong servant de parallèle à l’état du pays. Il dépeint par la même occasion une situation glaçante tristement réaliste d’emprise d’un homme sur son entourage. Mila ne peut se résoudre à partir, une inaction liée à la peur permanente dans laquelle elle baigne depuis sa naissance, cumulée au risque de perdre son emploi et que Dadong la rattrape grâce à son réseau dans la police ; sa mère n’a nulle part où aller et essaye de contenter son conjoint pour dévier la violence ; et leur bonne, probablement une campagnarde sans le sou, a besoin de son travail pour vivre. Même Noel s’écrase face à Dadong quand il doit le confronter.
Kisapmata est une tragédie oppressante dont on sait dès le début qu’elle va se terminer dans le sang (l’affiche d’origine spoile d’ailleurs allègrement la conclusion et j’ai dû me rabattre sur un poster alternatif d’une piètre qualité). Les interprètes sont excellents, la photographie est superbe, avec une magnifique restauration proposée par Carlotta en Blu-Ray. Les thèmes traités sont extrêmement durs, notamment celui de l’inceste, mais c’est fait de façon fine, sans voyeurisme ou excès. C’est à la fois un efficace thriller psychologique et un portrait juste de violences intra-familiales.
Films vus seuls
Anónimo mortal d’Aldo Monti (1975, Anonymous Death Threat)

Anónimo mortal est le second et ultime Santo produit par Jaime Jiménez Pons bien qu’il soit sorti avant Santo vs. las lobas (1976). Tourné en 16 mm, il était probablement destiné à la télévision à l’origine. Il a été réalisé par l’acteur Aldo Monti, le comte Dracula de Santo en el tesoro de Drácula/El vampiro y el sexo (1969). Santo est épaulé par un sympathique duo, Yvette et Pablo, et bosse avec l’inspecteur Ponce. Ce dernier, accompagné d’Yvette, apparaîtra au côté de Blue Demon dans La mafia amarilla (1975) et Noche de muerte (1975), scénarisés par l'illustre Carlos Enrique Taboada à l’instar d’Anónimo mortal. Cela explique sans doute la qualité d’une intrigue étonnamment élaborée, sans trop de problèmes de cohérence et sans aucune touche de fantastique. Les personnages sont davantage travaillés que d’habitude, ça m’a fait penser à une sorte d’épisode de Chapeau melon et bottes de cuir période Purdey et Mike Gambit avant l’heure, avec Santo en John Steed qui supervise ses partenaires. Ces deux Santo de Jaime Jiménez Pons se sont avérés être de bonnes surprises, dommage qu’il n’en ait pas produit d’autres.
丹下左膳 妖刀濡れ燕 [Tange Sazen Yôtô nure tsubame] de Sadatsugu Matsuda (1960, Return of the One-Armed Swordsman)

Pas de chasse au trésor dans ce troisième Tange Sazen avec Ryûtarô Ôtomo. C’est encore un jeu de chaises musicales au niveau du casting, Isao Yamagata devient l’honnête magistrat, Hashizô Ôkawa un seigneur de Sôma, Ofuji est incarnée par une comédienne différente… La mise en scène échoit de nouveau à l’incontournable Sadatsugu Matsuda, un spécialiste des jidai-geki sériels fréquemment croisé sur ce blog. L’histoire est alambiquée, avec une flopée de factions qui s’affrontent, et on se perd sur l’identité des méchants et des gentils. Cela manque de profondeur, le schéma est galvaudé, j’avais préféré les deux épisodes précédents. A noter la présence de Satomi Oka en fille d'un maître d’escrime. Extrêmement populaire à la fin des années 50, elle était surnommée la princesse de la Toei et joua dans presque 150 longs métrages entre 1955 et sa retraite en 1965 après son mariage.

Rogelio A. González est surtout fameux en dehors du Mexique pour sa comédie noire El esqueleto de la señora Morales (1960) avec Arturo de Córdova. Après des débuts comme scénariste d’Ismael Rodríguez (il a coécrit le classique Los tres García (1947)), il enchaîna les tournages, réalisant au total 73 films selon imdb entre 1951 et 1983, dans une multitude de genres.
La nave de los monstruos propose un univers de SF désargenté avec des fusées en plastique, des costumes ridicules, et des extraterrestres sexy et peu farouches. Gamma est incarnée par Ana Bertha Lepe, une ex-miss Mexique qui démarra sa carrière en 1952 et fut plus célèbre pour un scandale (son père assassina son fiancé) que pour ses talents d’actrice. Elle n’était pas mauvaise en journaliste fouineuse dans la trilogie Santo contra el rey del crimen (1962)/Santo en el hotel de la Muerte (1963)/Santo contra el cerebro diabólico (1963). Beta est jouée par Lorena Velázquez, une spécialiste de l’horreur assez charismatique abonnée aux méchantes et apparue dans plusieurs Santo, notamment en cheffe des femmes vampires dans Santo vs. las Mujeres Vampiro (1962).
La nave de los monstruos est réputé chez les amateurs de SF fauchée, parfois comparé à un Plan 9 from Outer Space (1957) avec davantage de budget et de meilleurs interprètes. On pourrait également le rattacher au weird western à la sauce mexicaine, à l’image de la trilogie du Cavalier sans tête. Ana Bertha Lepe et Lorena Velázquez font le boulot dans un script évidemment sexiste, les costumes sont sympathiques et ça aurait pu donner une série B recommandable sans Eulalio González dit El Piporro dans le rôle de Lauriano. Il cabotine à fond, avec un humour relou et moult grimaces. C’était par ailleurs un chanteur de musique norteña, un genre que je ne connaissais pas et qui ne m’a pas enthousiasmé. C’est dommage car, à part ça, c’était plutôt plaisant.
馬鹿が戦車でやって来る [Baka ga tanku de yatte kuru] de Yôji Yamada (1964, The Donkey Comes on a Tank)

Baka ga tanku de yatte kuru est le troisième et ultime volet de la trilogie des Baka. Il ne présente aucune similitude avec les deux précédents, il leur a été accolé par la Shôchiku pour capitaliser sur leur succès. On retrouve le goût de Yôji Yamada pour les marginaux avec une famille d’excentriques composée de Sabu, de son frère qui s’imagine être un oiseau et de sa vieille mère sourde. A cause de leur bizarrerie, ils sont mis au ban de la société et Yôji Yamada prend clairement leur parti. Après une heure axée sur le quotidien de cette bourgade peuplée de farfelus, l’arrivée d’un tank entraine un changement de rythme. Les dix dernières minutes amorcent un nouveau virage, avec un évènement dramatique et une conclusion poétique. Ce mélange ne fonctionne pas complètement en raison de protagonistes caricaturaux qui manquent de profondeur et d’une intrigue sans grand enjeu. Bien que fort apprécié par Yôji Yamada lui-même, ce Baka ga tanku de yatte kuru ne m’a donc pas convaincu.
Livres
Legends of the Condor Heroes 1 – A Hero Born de Jin Yong (MacLehose Press, 2018), 396 p.

Jin Yong, nom de plume de Louis Cha Leung-yung, est un écrivain hongkongais spécialisé dans le wuxia, un équivalent chinois des romans de cape et d’épée généralement centrés sur des chevaliers errants dotés de capacités martiales extraordinaires. Entre 1955 et 1972, il a rédigé quinze œuvres de fictions, souvent en plusieurs parties à l’instar de Legends of the Condor Heroes composé de quatre volumes. C’est probablement l’auteur sinophone le plus populaire du XXe siècle avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus malgré le peu de traductions. En français, quatre opus ont été édités par la librairie You-Feng dont Legends of the Condor Heroes sous le titre La légende du héros chasseur d'aigles, dans une version abrégée apparemment scandaleuse. J’ai donc préféré me rabattre sur la traduction anglaise intégrale.
A l’inverse du taïwanais Gu Long dont j’ai lu deux-trois bouquins et vu une pléthore d’adaptations, je connais mal Jin Yong. Les transpositions de ses livres par la Shaw Brothers ont été tardives, plutôt situées dans la période de déclin du studio. Par rapport aux Quatre Brigands du Huabei ou à la série des Chu Liuxiang de Gu Long, Legends of the Condor Heroes I – A Hero Born est bien plus sombre et ancré dans l’Histoire. Les héros sont tragiques et extrêmement sérieux, avec une place significative donnée à Gengis Khan et à son entourage. Si les combats sont parfois trop longs, la multiplication des péripéties, des quiproquos et des trahisons plus ou moins vraisemblables chasse vite l’ennui. Le nombre de personnages majeurs reste raisonnable (on n’est pas dans Au bord de l’eau), l’intrigue se suit sans problème et j’attends le deuxième tome avec impatience.
Journal d'un chat assassin d’Anne Fine (L’école des loisirs, collection « Mouche », 2020), 74 p.

Anne Fine est une autrice anglaise spécialisée dans la littérature pour enfants. Son roman le plus connu est Madame Doubtfire, adapté au cinéma en 1993 avec Robin Williams dans le rôle principal. Paru en 1994 en Grande-Bretagne et en 1997 en France, Journal d'un Chat assassin eut un grand succès et fit l’objet de huit suites (curieusement, seules cinq d’entre elles ont été publiées en anglais alors qu’elles sont toutes disponibles en français). Le texte est plaisant et amusant, narré avec humour par un chat sarcastique. Je n’ai en revanche pas accroché aux dessins de Véronique Deiss, que j’ai trouvés un peu vulgaires et manquant de subtilité. Chaque pays propose ses propres illustrations, l’édition britannique d’origine me conviendrait sans doute davantage.
Revues
Les Cahiers du cinéma n°819 – Avril 2025

Pas grand-chose au niveau des sorties ou du patrimoine, il n’y a rien qui me tente. Le numéro se clôture par une intéressante interview de Michael Pangrazio, un directeur artistique américain expert en matte painting, qui se montre assez pessimiste sur l’avenir de sa profession concurrencée par l’IA.












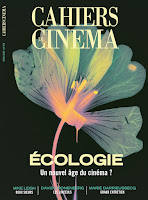
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire